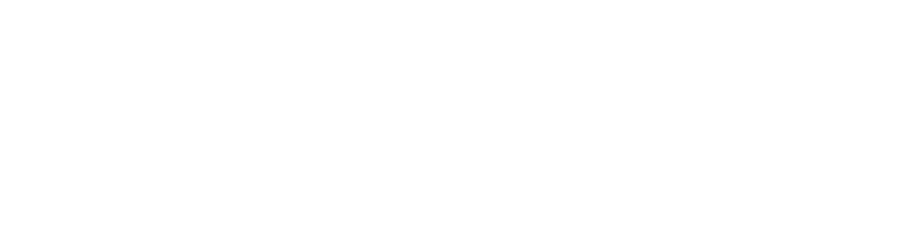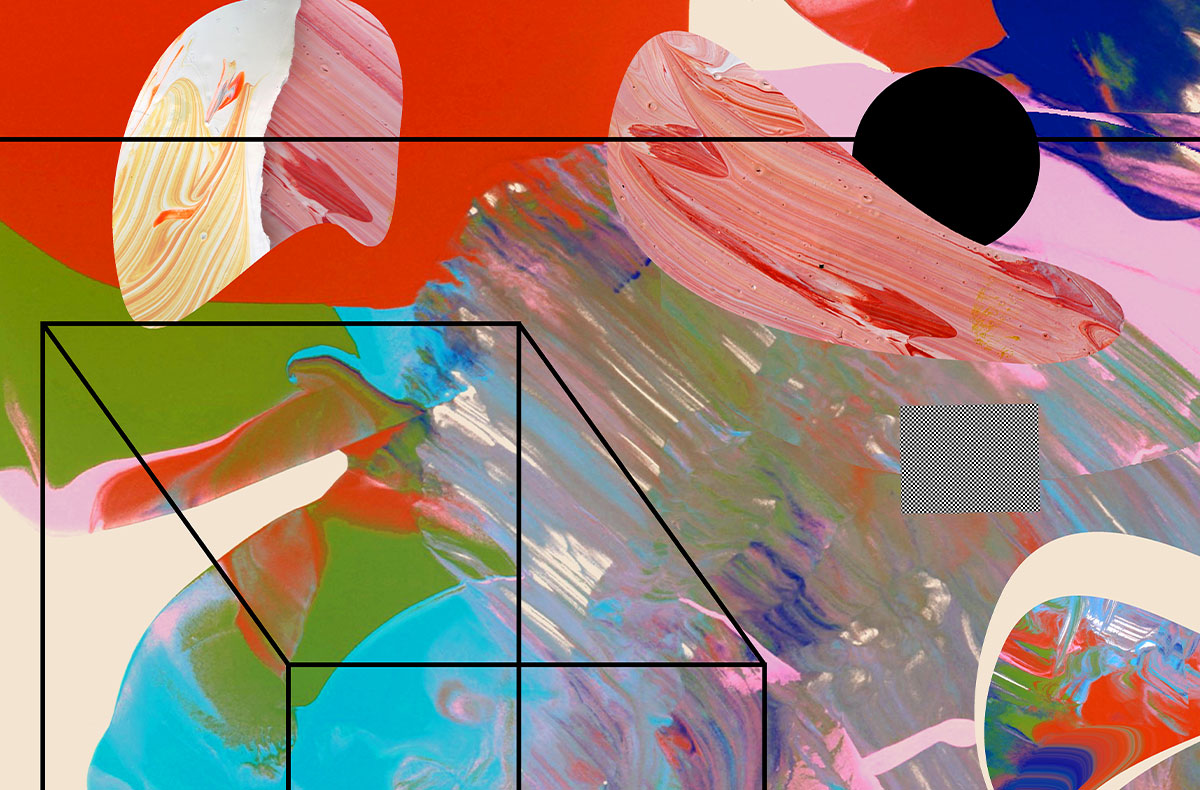Par David Maggs, Fellow Metcalf en arts et société
Dire que le monde a atteint un carrefour est une manière parmi d’autres de décrire la boule que nous avons collectivement dans la gorge. Comme l’explique l’ancien chercheur du GIEC, John Robinson : « Il n’y a aucun avenir qui n’est pas transformateur ». Compte tenu des dérangements accrus au sein de nos systèmes sociaux, économiques, politiques et environnementaux, tous les chemins mènent à des transformations et, comme le confirme notre expérience actuelle, aucun chemin ne nous transformera de manière plus désagréable que celui du statu quo.
Même si le secteur culturel à but non lucratif du Canada en est bien conscient, le système limite les mesures progressives. Au lieu de permettre l’expérimentation, d’encourager la transformation et d’approfondir notre résolution et notre impact, on constate que notre modèle de ressources plie sous les pressions croissantes, se transformant en amortisseur face à l’adversité.
Sommes-nous capables de réorienter notre modèle pour qu’il nous dirige vers des relations plus approfondies avec nos communautés, nos publics et nos marchés? Pouvons-nous préparer ce modèle à s’épanouir dans un monde différent de celui qui l’a vu naître, mais qui demeure un monde où le besoin de culture est urgent et profond?
Dans cette optique, la Fondation Metcalf s’est mise à explorer l’émergence de la finance sociale, ou de l’investissement d’impact, tant à travers le monde qu’ici au Canada. Nous avons été témoins d’importants flux de capitaux, dont les risques ont habituellement été atténués par des investissements publics, et qui s’efforcent de combiner un bon rendement financier et social, afin d’acheminer l’argent nouvellement accumulé jusqu’aux secteurs de la santé, de l’environnement, de l’éducation et de la justice, entre autres priorités sociales. Nous avons pu constater que sans les connaissances, les capacités et les structures qui permettent d’attirer et de déployer de tels capitaux, la culture tend à être laissée pour compte, à être exclue des nouvelles formes d’investissements et, de plus en plus souvent, à ne pas figurer sur la liste des secteurs des avantages sociaux.
Bourses vs. prêts
Mais comment la finance sociale peut-elle contribuer à répondre au défi de notre secteur, soit de cultiver de nouvelles ressources et capacités? Le risque inhérent aux prêts peut-il servir un système qui ne connaît que la sécurité des bourses? L’argent que nous devons rembourser peut-il nous servir alors que nous survivons à peine avec l’argent que l’on peut garder?
Je me penche sur ces questions sous deux angles. Récemment, j’ai eu l’honneur de travailler aux côtés de Fran Sanderson et Seva Philips, évaluant un projet pilote qui a introduit la finance sociale dans le secteur culturel du Royaume-Uni. Arts & Culture Finance (ACF), un fonds d’investissement d’impact, a amassé 33 M£ en capital d’impact pour la culture, alors qu’un important investissement d’Arts Council England a permis d’attirer des partenaires parmi les fondations et au sein du secteur privé, lesquels n’investissent pas normalement dans la culture.
Non seulement cette initiative a-t-elle offert de nouvelles ressources pour le secteur, mais elle lui a permis de bâtir de nouvelles capacités. Travaillant avec des prêts à faible taux d’intérêt et l’équipe qui les fournissait, des organisations du secteur des arts au sein d’ACF ont pu améliorer leurs modèles de gouvernance, leur gestion financière, leurs compétences entrepreneuriales, leurs liens avec la communauté, ainsi que leur capacité à identifier et formuler les plus vastes impacts sociaux et culturels de leur travail. Au terme d’une analyse économique détaillée, la plupart des organisations qui ont eu recours à des prêts d’ACF en sont sorties plus résilientes.
Considérons un autre exemple, celui-ci plus près de nous. Il y a environ dix ans, Camber Arts, l’organisation que je dirige conjointement dans l’ouest de Terre-Neuve, est arrivée à la conclusion qu’un financement opérationnel stable ne figurait pas dans notre avenir immédiat. Ayant donc besoin de trouver d’autres moyens d’atteindre la stabilité, nous avons développé un programme des arts de la scène pour les jeunes, mais il nous a fallu emprunter de l’argent pour les installations requises.
À ce moment-là, j’ai perçu la différence entre l’obtention d’une bourse et l’obtention d’un prêt. Chaque fois que j’avais eu la chance d’obtenir une bourse, c’était au terme de l’évaluation de ma demande par un jury de mes pairs, qui l’avait considérée au même titre que des douzaines d’autres demandes, et avaient jugé mon projet et ma vision dignes de financement. Au moment de recevoir la lettre d’acceptation, j’avais le sentiment d’avoir mérité cet argent. Si j’avais de comptes à rendre, c’était uniquement à la vision qui m’avait permis d’obtenir cette bourse, et si la valeur de ce qui allait en résulter n’était reconnue par personne, cela n’entraînerait aucune conséquence. Après l’obtention d’un prêt, en revanche, j’ai eu le sentiment inverse. Il fallait maintenant commencer à mériter cet argent. Il fallait maintenant nous montrer responsables envers le public, la communauté, ainsi que le marché qu’il nous fallait pour assurer le service de la dette. S’ils ne voyaient aucune valeur dans ce que nous nous apprêtions à faire, nous étions dans le pétrin.
Cette différence a transformé Camber Arts. Notre gestion des finances est devenue plus sophistiquée, nous avons affiné nos instincts commerciaux, nous avons bâti des analyses de rentabilité plus convaincantes pour nos activités, et nous avons centré notre engagement sur la communauté. Plutôt que de plier aux goûts du jour pour rembourser notre prêt, notre regard artistique était rivé sur le défi de comprendre et mieux servir les besoins culturels de notre milieu.
Quand je repense à cette expérience, il y a une seule chose que je changerais : j’aurais préféré ne pas être obligé de le faire à la dure. En l’absence d’un programme de prêts à faible taux d’intérêt au service de la culture au Canada, nous devions travailler avec BDC, qui garantit les prêts non traditionnels à des organisations comme la nôtre, mais à un taux d’intérêt plus élevé que les banques commerciales. Ayant moi-même célébré notre transition vers des prêts commerciaux conventionnels, je comprends parfaitement l’importance d’avoir une organisation comme ACF au Canada, afin de fournir aux organisations du secteur culturel des capitaux à un taux plus bas que celui du marché.
Réparer le seau
La chose la plus folle que l’on pourrait dire au sujet du secteur culturel sans but lucratif au Canada serait : « Nous avons assez d’argent ». Essayez-le. Fermez la porte de votre bureau et dites à voix haute : « Regarde donc ça! Nous avons déjà tout l’argent qu’il nous faut! » Ça peut sembler complètement cinglé, et dans les circonstances actuelles, il est possible que ce le soit.
Assurément, notre secteur adopte plutôt la croyance opposée : que la seule chose qui nous freine est de ne pas encore avoir reçu assez d’argent. Toutefois, la dernière décennie a fait la vie dure à cette croyance; en effet, malgré une décennie d’augmentations historiques du financement (2015-2025), notre secteur est désormais confronté à des niveaux records de précarité. Pourtant, pratiquement tout ce qu’on voit de la part de nos dirigeants culturels — tant les bailleurs de fonds que les organisations — montre qu’ils s’obstinent à maintenir cette croyance. Pourquoi? Y a-t-il des gens qui croient vraiment qu’il suffirait d’une dernière augmentation de 10 % du financement pour assurer la durabilité de notre secteur? Qu’avec un dernier petit coup de pouce sous forme de bourse, tout ira sur des roulettes à partir de là?
Les idéologies pathologiques sont de fausses croyances qui guident nos efforts visant à régler nos problèmes de manières qui, par inadvertance, ne font qu’empirer ces problèmes. C’est là une caractéristique commune des systèmes en déclin. Qu’il s’agisse de corporations ou de civilisations entières, cette tendance humaine à se laisser profondément aveugler par des principes fait de l’ironie tragique un fil conducteur de l’histoire de l’humanité.
Imaginez que vous observez quelqu’un en train de verser de l’eau dans un seau troué, et qui panique et se démène pour constamment trouver plus d’eau afin que le seau ne se vide pas complètement. Tôt ou tard, vous aurez envie de lui dire : « Eille, peut-être que ce serait mieux de réparer ton seau, non? » Initialement, cette personne n’aura probablement pas envie de vous écouter. Elle vous dira sans doute que c’est impossible. Elle énumérera toutes les choses qui ont déjà été tentées, y voyant une raison de ne rien essayer de nouveau. Peut-être même qu’elle vous dira que le seau est sensé être troué, parce que c’est comme ça que fonctionnent les vrais bons seaux.
Des capitaux hybrides pour des mondes meilleurs
Si la Fondation Metcalf s’intéresse tant à la finance sociale pour le secteur culturel canadien, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un autre moyen de se démener pour trouver encore plus d’eau, mais parce que ça pourrait nous permettre de réparer le seau. Cet intérêt est né en 2018, alors que deux Fellow Metcalf, Elizabeth MacKinnon et Christine Pellerin, ont écrit More Than Money, et il a pris de l’ampleur après la pandémie, au moment où des modèles alternatifs d’obtention de ressources ont commencé à être mieux appréciés. Camber Arts et Metcalf ont coparrainé un rassemblement de bailleurs de fonds et de dirigeants financiers à Toronto en juillet 2023, pour ensuite collaborer avec les Conseils des arts de l’Ontario et du Canada à la réalisation d’une étude de faisabilité visant à examiner le paysage de la finance sociale et des arts au Canada. En janvier dernier, nous avons réuni des bailleurs de fonds publics du secteur des arts des quatre coins du pays pour poursuivre le dialogue, et nous nous préparons à inviter un plus vaste éventail de voix au sein du secteur au printemps 2026. Nous collaborons présentement avec Rally Philanthropy afin d’entreprendre une exploration de développement d’un fonds pilote qui aura pour mandat de cultiver la capacité des bailleurs de fonds et des praticiens du secteur des arts d’adopter cette approche.
Parallèlement à ce travail, je participe à des réunions portant sur le financement mixte et j’ai été inspiré par des projets liés à la sécurité alimentaire, aux carrefours communautaires, à la prestation de soins de santé, aux services d’accueil des nouveaux arrivants, entre autres innovations sociales. Tant de gens travaillent d’arrache-pied pour nous assurer un meilleur avenir. Cette approche novatrice du financement peut façonner des alliages uniques et stratégiques de bourses et de prêts qui permettront de faire de ces avenirs possibles des réalités présentes. Le temps passé avec ces gens a été pour moi une leçon d’humilité et une expérience déroutante, qui a provoqué une espèce de vision hallucinatoire : le secteur culturel canadien dispose déjà de l’argent qu’il lui faut pour réussir et répondre aux besoins de notre pays en matière de culture.
Ou est-ce bien vrai? Peut-être n’avons-nous pas besoin de plus d’argent? Peut-être faudrait-il renoncer à cette idéologie pathologique qui peine à reconnaître la présence du trou dans notre seau, qui a du mal à concevoir de ce que nous pouvons accomplir avec notre argent au-delà des bourses, et qui n’arrive pas à imaginer les activités dignes d’investissements se trouvant au-delà de nos modèles d’affaires actuels. Si les innovateurs sociaux qui participent à ces réunions mixtes sur la finance étaient au courant des ressources à notre disposition, ils seraient assurément jaloux. Nous avons déjà l’argent qu’il nous faut pour stimuler l’innovation, susciter les transformations et avoir un impact social et culturel immense. Pourtant, lorsqu’on observe l’habileté avec laquelle certains secteurs font les liens entre l’investissement et l’impact, notre approche semble soudain paresseuse et complaisante.
Imaginez si l’on pouvait se donner pour but de convertir 20 % du financement public envers les arts en un capital catalyseur permettant de créer un fonds de finance sociale à faible taux d’intérêt pour la culture?
Cet argent attirera d’importants nouveaux investissements de la part de fondations et d’investisseurs du secteur privé, créant une nouvelle ressource substantielle pour les activités culturelles. Cela mettra le fonds – et les prêts – à l’abri du risque, tout en maintenant les taux d’intérêt bas. Cela appuiera le renforcement des capacités pour les organisations sans but lucratif du secteur culturel, en les préparant pour les investissements et en développant les activités dignes d’investissements. Cela créera un appétit pour le risque, en s’assurant que les prêts peuvent être mis au service d’activités créatrices qui cadrent avec la mission de l’organisation. Cela permettra l’évolution du succès grâce à des incitatifs au rendement. Cela développera des pratiques de rapports d’impact qui repositionnent la culture aux côtés des autres secteurs d’avantages sociaux, rehaussant ainsi notre statut à titre de priorité stratégique clé aux yeux de tous les paliers du gouvernement. Cela favorisera l’épanouissement d’organisations culturelles sans but lucratif qui se montrent plus résilientes, plus impliquées dans la communauté et moins dépendantes des bourses. Et cela ne cessera de nous rapporter des dividendes, se recyclant à l’échelle du secteur, renforçant la résilience du système à chaque nouveau cycle.
Le risque existe-t-il? Oui. À l’instar de n’importe quel moteur, le risque est au cœur de ce véhicule de ressourcement. Mais nous pouvons le concevoir de façon à minimiser ce risque de différentes façons. Nous pouvons lui donner des pneus de caoutchouc, une suspension rebondissante et des sièges confortables, mais si le risque n’est pas là pour aiguiser l’attention et assurer la responsabilisation, ce véhicule ne pourra pas nous amener à de nouvelles destinations. Certains prêts risquent-ils d’échouer? Je l’espère bien. Sinon, nous ne poussons pas suffisamment les investissements en direction des défis et des débouchés propres aux activités du secteur. Certaines organisations risquent-elles même de s’effondrer? Possiblement. Mais cette perspective se profile déjà à l’horizon, sans le moindre avantage correspondant.
Il n’existe aucun avenir pour notre secteur qui ne soit transformateur. Le risque que nous regretterons d’avoir couru est le risque de ne rien faire. Il serait contre-productif et démoralisant de s’entêter à suivre les modes actuels en déclin et de se disputer pour notre part des ressources habituelles qui atteignent notre secteur par l’attribution d’un héritage calcifié, de miser sur le lobbying des amis du gouvernement ou sur toute autre approche consistant à tirer à l’aveuglette dans le tas. Les Canadiens méritent un secteur culturel qui est fort, engagé et mobilisé, et notre pays en a plus que jamais besoin. Les ressources qui nous permettront de répondre à ce besoin existent déjà, pour peu que nous choisissions de les utiliser.